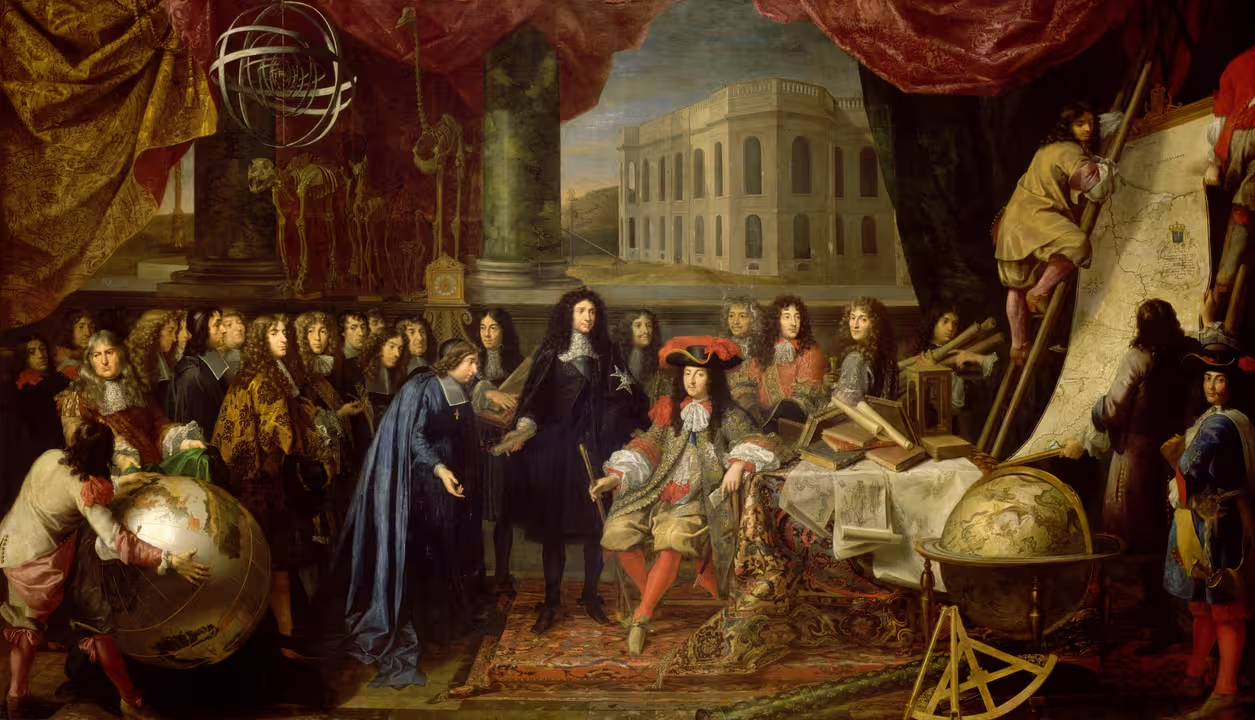Les despotes éclairés cherchaient à incarner l’idéal platonicien du roi-philosophe. Ces dirigeants étaient très instruits et idéalisaient la théorie libérale. Les idéaux éclairés qui formèrent une génération de dirigeants furent largement perpétués par le penseur satirique français Voltaire.
En transformant les traités philosophiques en art – pièces de théâtre, poésie et autres – Voltaire défendit à lui seul une floraison tolérante des arts et un libéralisme progressiste rationnel dans ses fondements politiques éclairés. Découvrons-en davantage sur le Siècle des Lumières.
Le Roi Frédéric II de Prusse – Frédéric le Grand

Le Roi Frédéric II le Grand de Prusse (r. 1740-1786) était un despote éclairé et un ami proche de Voltaire. Dans sa jeunesse, le roi allemand excellait dans le domaine de la philosophie, incorporant finalement l’idéalisme philosophique dans son règne.
Frédéric s’entoura à la cour de musiciens, d’écrivains, d’artistes et de penseurs, y compris le fils du compositeur allemand Johann Sebastian Bach. Bien que le début de son mandat fût plutôt tumultueux et violent contre l’Autriche et la Pologne, l’État prussien s’étendit et s’établit comme une puissance mondiale sous sa direction, bien qu’au prix d’une rivalité à vie avec sa contemporaine l’Impératrice Marie-Thérèse.
Sous Frédéric, les arts allemands prussiens prospérèrent. Son peuple jouissait des plus hauts niveaux de liberté légale en Europe. La tolérance religieuse et sociale prévalut – bien que Frédéric exprimât encore notoirement des sentiments antisémites et persécutât les catholiques en saisissant les terres cléricales pour lui-même. Frédéric introduisit également l’éducation obligatoire pour les garçons et les filles de 3 à 14 ans aux frais de l’État.
La tolérance ouverte de Frédéric encouragea l’immigration qui alimenta l’État prussien en expansion et permit à la population de se remettre de la guerre.
L’Impératrice Catherine II de Russie – Catherine la Grande

L’Impératrice Catherine II la Grande de Russie (r. 1762-1796) était également une amie proche et correspondante à vie de Voltaire. Née princesse allemande, la despote éclairée revendiqua le trône russe de son propre chef via un coup d’État : s’emparant du pouvoir de son mari et second cousin, l’incompétent Tsar Pierre III.
La Russie prospéra sous son impératrice allemande. Catherine incarnait le Siècle des Lumières ; très instruite, cultivée et versée dans l’histoire de son peuple. L’Impératrice tenta de gouverner dans le même style que le grand « occidentalisateur » de la Russie, le grand-père de son défunt mari, le Tsar/Empereur Pierre Ier le Grand (Pierre le Grand) (r. 1682-1725).
Catherine institua une réforme juridique, assouplit la loi sur la censure et étendit le territoire russe par la guerre. Bien qu’elle eût souvent idéalisé l’idée d’émancipation, la Russie adhéra à sa structure sociale fasciste de servage féodal sous Catherine et le resterait jusqu’aux années 1860.
Catherine créa également une délégation composée de fonctionnaires de chaque province et classe sociale en Russie (sauf les serfs) afin de vraiment gouverner sur les conseils de son peuple. Contrairement aux idéaux éclairés, Catherine favorisa fortement sa classe noble : le servage se maintint par crainte que son abolition ne paralyse l’économie agraire de la Russie.
L’Impératrice Marie-Thérèse du Saint-Empire romain et d’Autriche

L’Impératrice Marie-Thérèse (r. 1740-1780) était une impératrice Habsbourg du Saint-Empire romain et servit comme Reine d’Autriche, de Hongrie et de Croatie (parmi beaucoup d’autres) en plus de donner naissance à seize enfants durant sa vie. Bien que l’Impératrice régnât comme co-monarque aux côtés de son mari et de son fils aîné, Marie-Thérèse se réserva le contrôle absolu de son État.
Marie-Thérèse grandit plus intéressée par les arts que par la politique. Au début de son règne, son contemporain Frédéric le Grand de Prusse envahit son royaume. Cette attaque ambitieuse déclencha une rivalité et une inimitié à vie entre les deux souverains allemands. Frédéric étant protestant et Marie-Thérèse catholique, cet événement poussa Marie-Thérèse à exercer son despotisme éclairé en défense de son église et de sa dynastie familiale – conservativement.
Sous Marie-Thérèse, Vienne devint la capitale culturelle de l’Europe du Nord et incarna le Siècle des Lumières. La despote éclairée réduisit le pouvoir de l’église dans son domaine, sépara l’église du système éducatif (et l’étendit), et élargit le rôle de son gouvernement central pour réduire celui de sa noblesse terrienne. En réduisant l’autorité des propriétaires terriens, Marie-Thérèse pensait favoriser les serfs.
Marie-Thérèse était farouchement intolérante envers les autres confessions et cherchait avant tout à renforcer son Église catholique face à une menace de la Prusse.
Le Sultan Sélim III de l’Empire Ottoman et le Siècle des Lumières

L’Empire ottoman à l’époque des Lumières était suffisamment vaste pour border l’Empire russe au nord-est et les Habsbourg au nord-ouest. L’Empire musulman avait une emprise européenne en Grèce et dans les Balkans qu’il conserva jusqu’en 1913.
L’Empire était dirigé par le despote éclairé Sélim III (r. 1789-1807) durant le Siècle des Lumières. Selim était un musicien et poète passionné et possédait une profonde appréciation pour la littérature et les arts.
Le Sultan était régulièrement en guerre avec ses homologues européens à l’époque des Lumières : spécifiquement avec la Russie et le Saint-Empire romain. L’état de guerre accru (qui existait sur les frontières périphériques de l’Empire turc plus ou moins jusqu’à l’ascension de Napoléon) conduisit Sélim III à émettre une série de réformes.
Le despote éclairé introduisit des principes éclairés dans une réforme militaire (basée sur la tactique militaire européenne occidentale), ainsi que l’importation d’œuvres écrites occidentales traduites en turc, et un système d’éducation obligatoire plus large. L’Empire ottoman a une longue histoire de tolérance religieuse car l’empire était si vaste à son apogée.
Le Roi Charles III d’Espagne

Le Roi Charles III d’Espagne était un despote éclairé et un partisan du régalisme : la doctrine de l’autorité séculière d’un monarque surpassant la faculté ecclésiastique. Un principe central du Siècle des Lumières était l’accent mis sur l’humanisme. Si la couronne espagnole, dirigée par Charles III, réduisit le pouvoir de l’église, c’était pour le peuple espagnol.
Les réformes éclairées de Charles III adoptèrent une politique humaniste rationnelle similaire à celle de ses contemporains despotes éclairés. Les réformes espagnoles incluaient une réforme économique et sociale dans laquelle l’autorité de l’église était réduite dans la sphère de la vie publique. L’État espagnol poussa la politique éclairée plus loin en supprimant totalement les monastères, confisquant leurs terres, et même en exilant les Jésuites d’Espagne.
Bien que le despote éclairé parvînt à orienter son opération politique vers une perspective plus humaniste, son traitement sévère de son clergé porta un coup massif à sa classe noble. Charles est largement considéré par les chercheurs comme le sauveur d’une couronne espagnole en perdition.
L’Empereur Joseph II du Saint-Empire romain

L’Empereur Joseph II du Saint-Empire romain (r. 1765-1790) – souvent également appelé « Kaiser », la prononciation allemande du titre autocratique romain antique « César » – était le fils aîné et héritier de Marie-Thérèse. Il est souvent considéré comme le despote éclairé par excellence.
Une grande partie des réformes éclairées promulguées par sa mère furent instigées par Joseph. Bien que son règne initial fût éclipsé par sa mère, Joseph n’hésita pas à émettre davantage de réformes éclairées lorsqu’il succéda lui-même au trône.
En 1781, Joseph II émit à la fois le Brevet du Servage et l’Édit de Tolérance : le droit de servitude féodal fut redéfini et plus de droits d’égalité furent accordés aux minorités religieuses au sein des frontières de l’empire.
Joseph II lutta pour abroger le pouvoir du clergé et de l’aristocratie. Le despote éclairé était également un immense mécène des arts.
Dans le symbolisme de ses réformes libérales radicales, l’Empereur remarqua fameusement, « tout pour le peuple, rien par le peuple » – formulation citée dans le Discours de Gettysburg d’Abraham Lincoln quatre-vingts et deux ans plus tard en 1863.
L’Altruisme des Despotes Éclairés
La philosophie politique derrière le Siècle des Lumières en était une d’altruisme romantique. Les despotes éclairés absolutistes cherchaient à gouverner avec bienveillance pour l’amélioration de leur peuple. Avec une ferme emprise autocratique sur le pouvoir politique, l’apparence de réforme gouvernementale qui renforçait le gouvernement, à son tour, renforçait le souverain.
L’humanisme mis en évidence dans le Siècle des Lumières présentait les monarques comme des êtres humains responsables des autres êtres humains dans leur domaine, plutôt que comme des dirigeants divinement nommés. John Locke fut le premier à suggérer (radicalement) : si nos dirigeants humains ne peuvent pas protéger adéquatement nos droits humains, nous le peuple avons le pouvoir de changer ce dirigeant.
Le Siècle des Lumières se niche dans notre récit historique à la veille de l’Âge des Révolutions : en 1776, les États-Unis se révoltèrent ; en 1789, la France se révolta. Comme le dit si éloquemment Joseph II, la politique éclairée est menée pour le peuple, mais jamais par le peuple – l’auto-gouvernement des jeunes États-Unis étant le remède. Comme Aristote le dit fameusement : « celui qui ne peut pas vivre en société, ou qui n’a besoin de rien parce qu’il se suffit à lui-même, ne fait point partie de l’Etat ; c’est une brute ou un dieu.. »